S’il est bien une chose que l’on ne saurait contester au XIXe siècle français, c’est qu’il fut copieusement rempli. Politiquement, artistiquement, il y en a pour tous les goûts. Tandis que la grande Révolution y résonne toujours et que ses échos s’appellent droit de vote, parlementarisme et libéralisme, une autre révolution, industrielle celle-là, apporte le chemin de fer et les barricades.
Toutefois,
on ne peut manquer de sentir que les soubresauts du XIXe siècle comportent une
part d’artificiel : ils masquent en effet une continuité immuable, celle
des personnes et des lieux. Au fond, malgré tout ce qui bouge, le pays demeure.
Mais ce n’est pas parce qu’elle permane que la France est pour autant immuable,
n’est-ce pas ?
En juillet
1868, alors qu’il paraît invraisemblable que l’Empire de Napoléon III en
cours de libéralisation puisse vaciller, même à moyen terme, un homme de lettres
de 39 ans publie un ouvrage politique qui, pour citer sa quatrième de
couverture, « fait l’effet d’une bombe. »
Référence : PRÉVOST-PARADOL Anatole, La France nouvelle, Paris, 1868. (Réédité par Perrin, collection « Les mémorables », en 2012, 323p. avec une présentation de Gabriel de Broglie)
⁂
Lucien-Anatole Prévost-Paradol, né à Paris en 1829, est le fils illégitime que sa mère de la Comédie-Française eut avec Léon Halévy. (L’aïeul du dramaturge Ludovic Halévy, de l’historien Daniel Halévy, et des ministres Louis et Pierre Joxe. Quelle famille !)
.jpg) |
| Prévost-Paradol vers 1865 |
Appartenant depuis sa jeunesse à l’opposition libérale au Second Empire, il est d’abord professeur de littérature à Aix-en-Provence puis, surtout, journaliste prolifique au Journal des débats, une feuille de tendance libérale-orléaniste, pour laquelle il tient une chronique politique quotidienne. C’est par là qu’il se fait précocement connaître : « Il entrait à vingt-huit ans [en 1857], par la grande porte, dans le journalisme politique d’opposition sous un régime d’une extrême sévérité qui imposait prudence et sérieux, mais exigeait aussi, pour percer, beaucoup d’audace et de subtilité. Paradol n’en manque pas, bien au contraire. » (pp. 10-11)
Plusieurs
fois condamné par le régime, dont une fois à une peine de prison d’un mois, il
se trouve néanmoins confronté à un dilemme moral. En 1860, l'Empire évolue vers
plus de libéralisme, avec toutes les apparences de la sincérité : faut-il
accepter cette main tendue ? Il semble dans un premier temps répondre à
cette question par la positive, avant d’adopter une posture plus médiane que
résume Gabriel de Broglie dans sa présentation : « les mesures vont
dans le bon sens, il faut les utiliser, mais elles ne sont pas suffisantes, le
gouvernement doit démontrer la pureté de ses intentions et doit surtout aller
plus loin [...]. » (p. 12). C’est en substance ce qu’Emile Ollivier dira
au même moment à Morny, président du Corps législatif : « Si c’est une
fin, vous êtes perdus ; si c’est un commencement, vous êtes fondés. »
Paradol
demeure opposant de fond à l’Empire ; les années suivantes le voient
maintenir sa trajectoire contestataire orléaniste. Proche de Thiers, il
envisage même d’entrer en politique à l’occasion des législatives de 1863, mais
ce projet échoue, et il n’est pas élu. Lot de consolation, l’Académie Française
l’accueille en 1865 (il n’a que 36 ans), même si son élection produit des
remous dans le microcosme parisien de la république des lettres.
| Georg Bleibtreu, La Bataille de Königgrätz (Sadowa), 3 juillet 1866, 1869 |
Le 3 juillet
1866, la Prusse bat l’Autriche à Sadowa. Peu de français prêtent alors grand
intérêt à cet événement, et encore moins ne conçoivent les risques qui résulteraient
pour la France de ce nouvel équilibre des forces en Europe centrale. Au milieu
de la fête impériale, Paradol est l’un des rares à sonner l’alarme :
« Je me demande sincèrement quel plus grand dommage pourrait être infligé
à la grandeur française, écrit-il, si c’était nous qui avions perdu la bataille
de Sadowa. »
En 1868,
Paradol a besoin d’exprimer ce qu’il perçoit à propos de la situation de la
France, non sans une certaine angoisse proto-gaullienne. Gabriel de Broglie
estime que « S’il est […] une qualité qu’on doive lui reconnaître, c’est
la préscience des enchaînements historiques. » (pp.
21-22) Fondamentalement pessimiste, il avait compris que la politique
étrangère de Napoléon III comportait un double tranchant particulièrement acéré.
« Ses prévisions sont […] des constructions dignes d’un mécanicien de la
politique. » (p. 24)
Ce besoin de s’exprimer produit, en juillet 1868, La France nouvelle, véritable manifeste politique à vocation programmatique, couvrant tous les aspects de la société. D’environ 270 pages, c’est un succès littéraire, « Le livre fit le sujet de toutes les conversations, connut plusieurs éditions en quelques jours, fut commenté par tous les journaux et âprement discuté par la classe politique. » (p. 7)
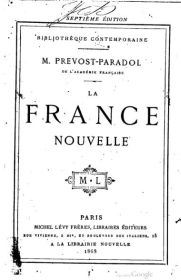 |
| Edition de 1869 |
1. – La forme de l’ouvrage
La France nouvelle s’ouvre par une courte préface de l’auteur dans laquelle il se place immédiatement au-dessus de la mêlée (encore une analogie gaulliste) : « Voici, par exemple, un livre […] qui, inspiré par le seul sentiment du patriotisme, est entièrement dégagé, on le reconnaîtra sans peine, de l’esprit de secte et de parti. » (p. 37). Paradol présente son ouvrage comme l’aboutissement d’une mûre réflexion politique à vocation globalisante : ce livre, de ses propres termes, « esquisse le plan d’une réforme générale qui embrasse tout l’Etat, depuis l’exercice du droit de suffrage […] jusqu’à l’organisation et au fonctionnement du pouvoir suprême. » (p. 40)
Ce qui
singularise d’emblée l’auteur par rapport à ses contemporains qui, tout au long
du XIXe siècle, ont réfléchi également sur ces sujets, c’est l’indifférence
fièrement revendiquée par Prévost-Paradol pour les questions relatives à la
forme extérieure du régime. Cette posture idéologique, rare à l’époque, procure
à cet ouvrage un caractère – j’ose le dire – prodigieusement actuel : en
s’abstrayant de toute pensée quant à la forme idéale du régime (monarchie
légitimiste ou orléaniste, empire, république) le substrat idéologique de
Prévost-Paradol nous apparaît curieusement praticable,
pour nous, lecteurs du XXIe siècle, à une époque où, nous non plus, nous
n’avons plus le réflexe d’incorporer dans nos réflexions politiques les
questions de forme du régime, tant la République semble une évidence appelée à
durer éternellement.
 |
| Léon Coignet, Les Drapeaux, 1830 |
Paradol se justifie de la façon suivante : « Ce n’est pas que je n’aie comme tout le monde sur ces divers points mon inclination particulière et mes préférences personnelles, mais je persiste à appeler ces questions des questions secondaires, à côté de la question capitale de la réforme politique et administrative de la France. […] Ces questions de mots et de personnes qui, pour trop de Français, résument tout ce qu’ils entendent par le terme de politique, sont dominées, à mes yeux, par une question beaucoup plus importante : celle de savoir si nous serons enfin libres. » (pp. 40-41)
L’ouvrage en lui-même est composé de trois livres :
- Le premier livre compte 6 chapitres : il aborde des thématiques introductives de philosophie politique et se centre autour de la question de la démocratie : qu’est-ce qu’une démocratie, comment naît-elle, quels sont les maux qui la menacent ?
- Le deuxième livre compte 10 chapitres. Intitulé Des institutions et des principes de gouvernement qui conviennent à la démocratie française, c’est le cœur de l’ouvrage, dans lequel Paradol expose, thème par thème, son programme politique (droit de suffrage, assemblées locales, chambre basse, chambre haute, responsabilité ministérielle, rôle du chef de l’État, organisation de la magistrature, presse, administration des cultes et organisation de l’armée)
- Le troisième livre compte 3 chapitres et entend replacer les débats dans un contexte historique et ouvrir la discussion sur un futur redouté (De la chute de nos gouvernements depuis 1789 ; Des signes les plus apparents de la décadence française ; De l’avenir)
2. – Exposé sommaire de la pensée politique de Prévost-Paradol
Il ressort à
la lecture de cet ouvrage qu’Anatole Prévost-Paradol est attaché en premier
lieu à la démocratie : il distingue subtilement la société démocratique
d’avec le gouvernement démocratique, expliquant que, si l’une appelle l’autre,
l’une peut théoriquement exister sans l’autre. Ainsi, lorsqu’une société est
devenue démocratique (et ce mouvement est, selon lui, naturel), il est de
l’intérêt de l’État que son gouvernement le soit également. Le bon gouvernement
doit enfin éviter les formes déréglées de la démocratie que sont l’anarchie et,
surtout, le « despotisme démocratique », sous lequel les libertés
sont inévitablement réduites à portion congrue.
Ensuite, puisque
ces fléaux sont inépuisables (car humains), il importe de bâtir un gouvernement
démocratique dont les fondations soient solides. C’est le deuxième livre qui présente ainsi les conceptions
institutionnelles et sociales propres à affermir la forme française de la
démocratie. Il s’agit véritablement de propositions de réformes dont l’auteur
estime qu’elles « peuvent renouveler la face de notre pays et fonder enfin
la liberté au sein de la démocratie française. » (p. 224)
Dans son programme,
notons par exemple qu’il anticipe la séparation de l’Église et de l’État, dont
il estime qu’elle adviendra naturellement. De plus, prenant pour base le modèle anglais
dans sa conception de la société (orléanisme oblige), il se montre favorable à
la décentralisation en des termes étonnamment modernes, dans la mesure où ces
échelons formeraient les citoyens à la vie publique : « Le self-government ou gouvernement de
soi-même, doit pénétrer jusque dans nos communes rurales, et il faut qu’elles
apprennent à se gouverner à leurs risques et périls par le moyen des conseils
qu’elles auront librement élus. » (p. 93) Ce système permettrait ainsi « d’intéresser
enfin un grand nombre de citoyens à la bonne administration de la chose
publique […]. » (p. 96)
 |
| Allégorie de la République, 1848 |
Le chapitre VI sur le chef suprême du pouvoir exécutif est l’occasion pour lui d’évoquer les avantages et les inconvénients respectifs de la république et de la monarchie. Pour autant, l’auteur ne déroge pas à la règle qu’il s’est posée dans la préface, et se plaçant au-dessus de ces enjeux, il conclut en affirmant : « J’appelle bon citoyen le Français qui ne repousse aucune des formes du gouvernement libre, qui ne souffre point l’idée de troubler le repos de la patrie pour ses ambitions et ses préférences particulières, qui n’est ni enivré ni révolté par les mots de monarchie ou de république, et qui borne à un seul point ses exigences : que la nation se gouverne elle-même, sous le nom de république ou de monarchie, par le moyen d’Assemblées librement élues et de ministères responsables. » (p.139)
Enfin,
Paradol nous livre ses réflexions sur le passé et ses craintes sur l’avenir. Là
encore, le mode est irrésistiblement gaullien (nécessité de s’inscrire
dans une visée historique, angoisse de l’avenir quant à la grandeur de la
France dans le futur), et bien qu’il ne verse pas dans un lyrisme exacerbé, le
style est néanmoins assez grave et élégant pour marquer les esprits. Quelques
exceptions cependant, comme cette longue période classique sur laquelle s’ouvre
le premier chapitre du troisième livre :
« Notre histoire nationale, depuis 1789 jusqu’au jour où j’écris,
ressemble, de l’aveu de tous, à un roman ; elle est semée de plus
d’événements imprévus, de plus d’actions glorieuses, de plus de faiblesses
misérables, de plus de catastrophes que ne l’a jamais été dans un espace de
temps si court l’histoire d’aucun peuple ici-bas. » (p.227)
Cette
ouverture historique permet à Paradol de poser un diagnostic sur l’État de la
France en reprenant ses développements sur la démocratie : pour lui,
« la Révolution française a fondé une société [démocratique], elle cherche
encore son gouvernement. » (p. 227).
Au hasard, notons par exemple qu’orléaniste, il admire impartialement le Premier Empire, mais seulement son administration militaire : « il est absurde de contester, comme on l’a fait quelquefois, que jamais le génie de la guerre et de toutes les parties de l’administration qui touchent à la guerre, n’a été porté à ce point parmi les hommes. » Pour le reste, il déplore que la « prodigieuse intelligence » de Napoléon ait été si « étroite pour presque tout le reste, étrangère aux idées de justice, peu propre à comprendre l’histoire et le temps même où elle vivait, asservie à la passion de l’intérêt personnel et grossièrement aveugle sur cet intérêt même […]. » (p. 232)
Près d’un
demi-siècle avant Paul Valéry, Paradol expose enfin le fond de sa crainte, en
rappelant que les sociétés sont mortelles. Et la société française, d’après
lui, est menacée d’une mort qu’annonce sa lente et sourde décadence morale,
qu’il sent approcher : « On oublie trop de nos jours, lorsqu’on parle
de la grandeur et de la décadence des peuples, que les causes de ces grands
événements sont purement morales, et qu’il faut toujours en revenir à les
expliquer par un certain état des âmes dont les changements matériels […] ne
sont que la conséquence visible autant qu’inévitable. » (pp. 261-262)
Prévost-Paradol, posant l’existence de trois garde-fous moraux (Dieu, le devoir
et l’honneur), observe que les deux premiers ne jouent plus dans la France de
1868, et redoute que le troisième, dont le sens demeure vivace à ses
contemporains (comme en témoigne l’habitude du « point d’honneur »,
qui débouche sur de nombreux duels en France jusqu’à l’entre-deux-guerres)
ne perde peu à peu de sa teneur.
 |
| Les monarques à l'exposition universelle de 1867 (à Paris) |
À la faveur d’un parallèle avec la Grèce antique, il évoque que l’état de « corruption de la conscience publique » issu des habitudes de la politique fait reculer le point d’honneur dans toutes les sphères de la société : « On s’accoutume d’abord à louer, sous le nom d’habileté en politique, la fraude et la violence que le succès à récompensées […]. » (p. 270)
Pour
conclure sur toutes ces mises en garde, Paradol affirme avec gravité, au regard
de la situation internationale, que « La France approche de l’épreuve la
plus redoutable qu’elle ait encore traversée. » (p. 276). Soudain, le
lecteur, pensant finir docilement la lecture de ce riche ouvrage se trouve nez
à nez avec un passage, à première vue anodin, mais qui est des plus glaçants quand
on sait qu’il fut écrit en 1868 : « Examinons […] l’hypothèse d’une guerre
entre la France et la Prusse, quelle qu’en soit l’occasion ou le prétexte. […] Supposons
donc que la Prusse, seule ou secondée par la Russie, l’ait emporté. Il n’est
pas besoin d’insister pour sentir que ce serait le tombeau de la grandeur
française. La France ne serait certainement pas anéantie : il reste encore
en Europe assez de notions sur la nécessité d’un certain équilibre pour que
notre existence amoindrie parût encore utile à plusieurs puissances, et,
lorsque la jalousie de tous contre nous serait amplement satisfaite par notre
irréparable abaissement, […] la jalousie des neutres contre notre unique
vainqueur tendrait sans doute à nous laisser subsister, sans force et sans honneur,
au milieu de nos ruines. Il est même
possible qu’on ne nous enlève pas dès lors l’Alsace et la Lorraine ;
mais ce qui nous serait enlevé sans retour, ce serait le moyen de nous opposer
à ce démembrement le jour où notre rivale triomphante le jugerait praticable et
utile à ses intérêts, et ce jour ne tarderait guère. » (p. 279, 282-283)
Anatole Prévost-Paradol
avait anticipé jusqu’à l’épisode dit de la « crise Krieg-in-Sicht » de 1875, projet de Bismarck de mener une
nouvelle guerre préventive contre la France, devant le fait qu’elle se
rétablissait trop rapidement de sa défaite de 1871, afin de la mettre au tapis.
L'historien Arnaud Teyssier, évoquant La France nouvelle dans un article du Figaro du 21 septembre 2015, convoquait le souvenir de l'auteur pour appeler la droite à inclure dans son agenda politique une réflexion sur le sens de l'Etat (alors qu'il semblait évident que la droite gagnerait en 2017). Dans son résumé de l'ouvrage, il conclut : « Pour ce libéral, la France était un peu plus qu'une idée vague, et la politique un peu plus qu'une machine à slogans. C'est dire combien il était en avance sur son temps. Et sur le nôtre. »
 |
| Le traité de Francfort, 1871 |
3. – Tragique épilogue biographique
La publication de cet ouvrage fait de Prévost-Paradol un homme de poids dans la constellation de l’opposition libérale au régime. En 1869, toutefois, un nouvel échec aux législatives le convainc douloureusement que sa vraie place n’est pas dans l’arène politique mais sur les gradins de l’hémicycle. « En ce milieu de 1869, l’abattement de Paradol est profond. » écrit Gabriel de Broglie, cet échec s’ajoutant par ailleurs au décès de sa femme.
Cependant,
1869 voit se réaliser l’étape supérieure de la libéralisation du Second Empire.
Le républicain Emile Ollivier, bonaparto-compatible
dirait-on aujourd’hui, est nommé chef du gouvernement en janvier 1870, et « l’opinion
modérée et les milieux d’affaires approuvent la nouvelle orientation. […]
Les Orléanistes ne se croient-il pas destinés par leur supériorité à gouverner
le pays ? » d’autant que « nombreuses sont les personnalités se
ralliant ostensiblement au régime parlementaire de fait établi. » (p. 18)
C’est dans ce contexte que Paradol choisit lui aussi de se rallier à l’Epire
libéral, au grand désespoir de la plupart de ses soutiens.
Sa
popularité acquise grâce à La France nouvelle
lui permet de se voir proposer le poste prestigieux d’ambassadeur aux États-Unis, qu’il accepte le 15 juin 1870. Cette nomination est désapprouvée tant par
ses amis libéraux (dont Thiers) que par les diplomates de carrière : le parallèle
est bientôt établi entre son ralliement à Napoléon III et le remarquable
retournement de veste de Benjamin Constant en faveur de Napoléon Ier en 1815,
au moment des Cent Jours.
Or la guerre
est imminente. Anatole Prévost-Paradol a-t-il la certitude que la France ne saurait
vaincre la Prusse, malgré les réserves qu’il avançait dans son ouvrage, et qu’elle
est condamnée à une humiliation à plus ou moins brève échéance ? Toujours
est-il que l’angoisse du déshonneur de son pays le mine profondément. Paradol sait ;
il avait déjà compris ; il avait entrevu le désastre.
Le 19 juillet 1870, la guerre était déclarée par la France à la Prusse.
Le 20 juillet, Anatole Prévost-Paradol se suicidait d’une balle
en plein cœur, de l'autre côté de l'Atlantique.
Le 1er septembre, Napoléon III capitulait à Sedan.
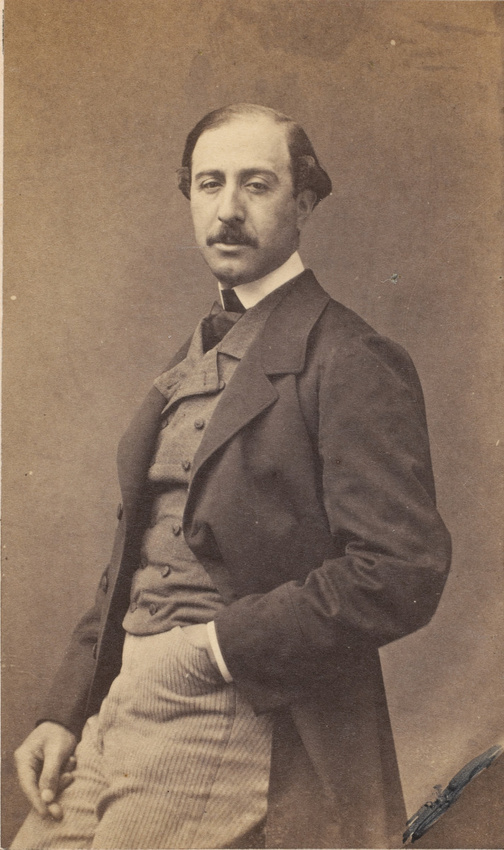 |
| Prévost-Paradol entre 1857 et 1865 |
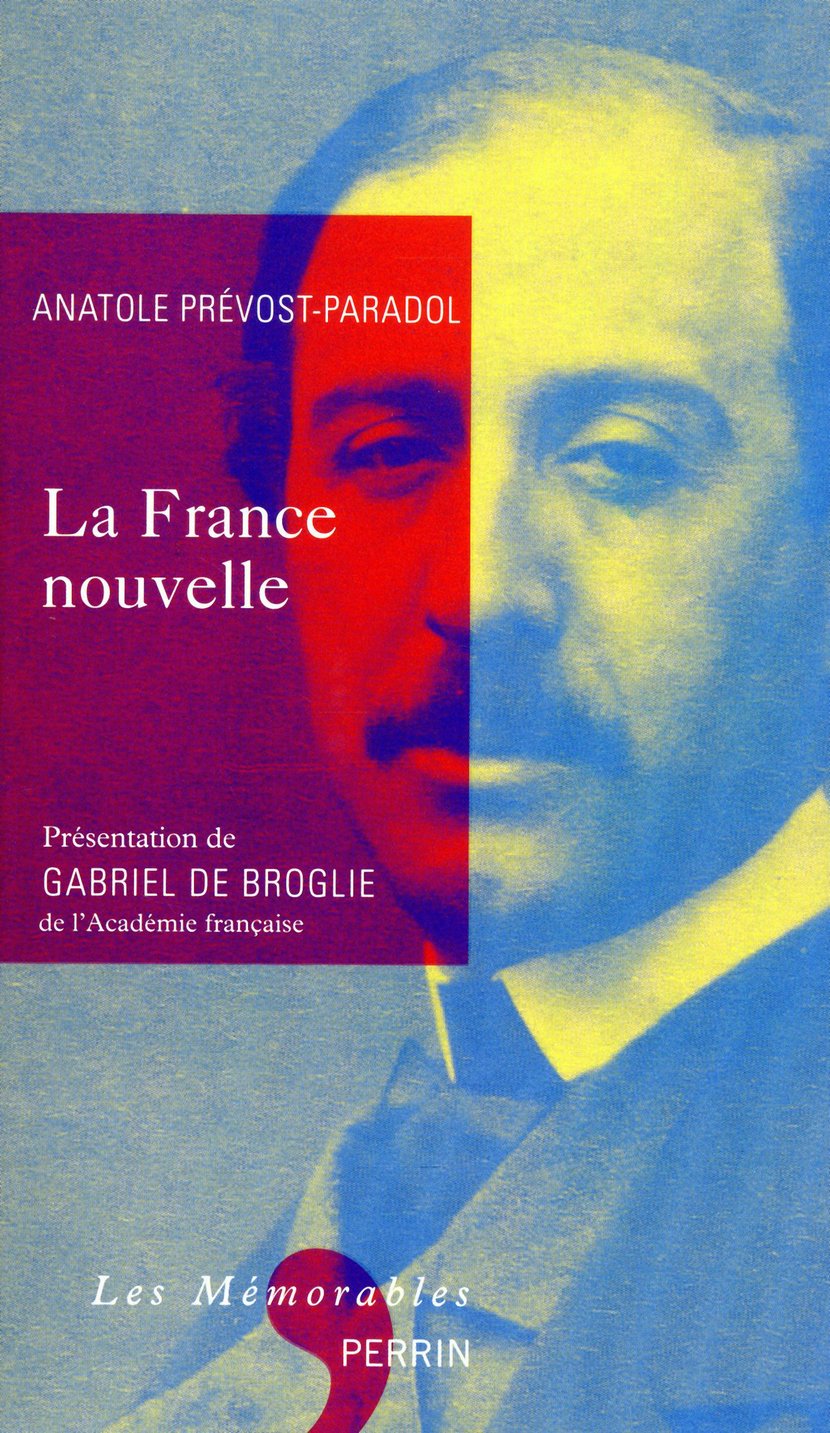
Commentaires
Enregistrer un commentaire
Débattre